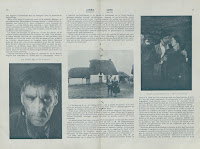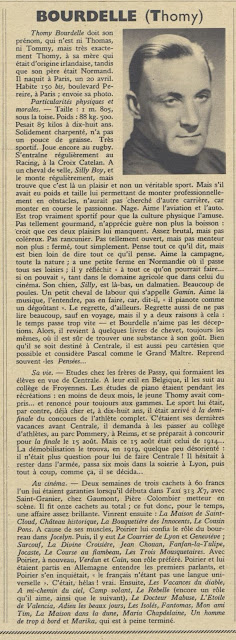vendredi 3 janvier 2025
La Maison Dans La Dune de Pierre Billon (1934).
mardi 31 décembre 2024
Thomy Bourdelle intime / Le Film Complet n°1696 / 26 Septembre 1935.
Si Thomy Bourdelle vivait en Amérique, il aurait certainement, au cinéma, une place aussi importante que celles de Douglas Fairbanks ou de Wallace Beery. Aux qualités sportives de ce dernier, à sa force, il allie la souplesse et la finesse sympathique du premier.
Malheureusement pour lui, l'athlétique comédien habite... Paris! Il est donc tributaire des fluctuations et des caprices du cinéma français, tel que les événements et la difficulté des affaires l'ont fait aujourd'hui. Après un rôle comme celui de L'Homme à l'oreille cassée, où nul mieux que lui n'aurait pu rendre possible les spirituels anachronismes voulus par l'auteur, Thomy Bourdelle était en droit d'espérer non plus seulement le succès... mais la fortune! Sa vedette, déjà très importante, avait encore grandi de notables proportions. Hélas ! l'excellent artiste n'a pas encore, à la minute présente, retrouvé un rôle à l'échelle du tumultueux colonel Fougas.
Dans la vie, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Dans notre cinéma, il en est de même pour les personnages que nos talentueux artistes sont appelés à incarner. C'est bien dommage!
Cavalier émérite, expert dans tous les sports, Bourdelle est, au demeurant, un excellent homme d'intérieur, ainsi qu'en témoignent les photographies que nous reproduisons, ici. Nous le voyons tour à tour dans son bureau, au milieu de tous les "Thomy Bourdelle" de sa carrière de vedette, examinant sa collection de pipes ou admirant l'esthétique d'un Jupiter Olympien qu'il vient d'acquérir dans quelque coin spécialisé de Paris. Le sympathique comédien se double, en effet, d'un amateur d'antiquités et d'art. Son intérieur est un véritable musée. Toutefois. l'amour de l'Ancien ne l'empêche pas d'avoir un souci scrupuleux de la ligne moderne. C'est lui-même qui affirme », chaque jour, les plis impeccables de son pantalon. Nul ne réussit mieux que lui le coup-de-fer tailleur », disent ses amis.
Le plus désagréable souvenir que Thomy Bourdelle ait gardé de sa carrière, est, pendant la réalisation de L'Homme à l'oreille cassée, l'opération du moulage de son visage, nécessitée par la fabrication de la momie qui le représentait après cent-quarante-neuf ans de léthargie. Un autre mauvais souvenir du sympathique comédien se réfère à la première vision de la dite momie, au studio, au moment où les sculpteurs chargés de l'exécuter l'avait révélé à leur... modèle ! Je me suis vu desséché et vieilli d'un siècle et demi, déclare Thomy Bourdelle. C'est une sensation que je ne souhaite à aucune jolie femme!
Le Film Complet n°1696 / 26 Septembre 1935.
dimanche 15 septembre 2024
En Tournant au Pays de "Maria Chapdelaine" par Thomy BOURDELLE ( Paris Soir / 25 août 1934 ) .
NOS VEDETTES ECRIVENT
En tournant au pays de "Maria Chapdelaine"
par Thomy BOURDELLE
L'Océan de Cherbourg à Québec. Arrêt à Québec. Juste le temps d'acheter quelques paires de mocassins, des bottes canadiennes, des splendides chemises à carreaux et des blousons authentiques qui auraient un succès fou à Deauville ou à Juan-les-Pins, et en route.
A Dolbeau, nous tournons les premières scènes. L'usine à papier en est le cadre et Gabin l'acteur. Puis nous allons à Honfleur, par un dédale de chemins creux et embourbés. C'est là que se situe la maison de Maria. Samuel Chapdelaine et Esdras (votre serviteur) « font de la terre ». c'est-à-dire qu'ils brûlent un coin de bois, déracinent les troncs et les souches et défrichent le sol pour l'ensemencer. A ce travail, on prend chaud, très chaud même. Ajoutez que les moustiques ne nous épargnent guère et vous comprendrez l'état d'esprit du bûcheron qui trime ainsi dans la forêt. C'est biblique !
Plus touristiques ont été les prises de vues sur les grands lacs et les rapides. C'est d'abord le canoë indien d'écorce de bouleau que chacun manie, au bout de quelques séances, comme un autochtone. Puis le lac incite au bain réparateur et les truites abondent. Nous tournons sur le grand lac Saint-Jean et les rapides environnants les scènes du début du film ainsi que toute la partie se rapportant aux Belges dans leurs tractations avec François Paradis.
A Péribouka, nous nous mélangeons intimement aux Canadiens qui figurent d'ailleurs nombreux dans les scènes de village. Nous avons l'occasion de remarquer combien est grande l'influence du curé tout comme aussi nous nous plaignons un peu de la frugalité et de la monotonie des repas qui nous sont servis.
Ce n'est pas de la grande cuisine, ni même de la cuisine simplement bourgeoise. C'est juste de quoi se sustenter pour tenir le coup !
A Montréal, nous tournons les scènes se rapportant à Lorenzo, l'homme de la ville. J.-P. Aumont montre à Maria (Madeleine Renaud) les beautés et les grandeurs de la ville. Les opérateurs adroitement embusqués prennent des scènes d'une vérité étonnante. Il est certain que Maria doit être ébaubie quand elle compare le paysage lunaire de son pays d'Honfleur (Canada) avec le modernisme tout américain des rues de Montréal.
Cela vous a une couleur folle, qui fait bien augurer du film. Toute la troupe de « Maria Chapdelaine ». son animateur Julien Duvivier, en tête, gardera, comme moi, un impérissable souvenir de son beau voyage.
Thomy Bourdelle
mercredi 11 septembre 2024
THOMY BOURDELLE MONTE SUR LES PLANCHES A PONTOISE (1937).
samedi 4 mai 2024
mardi 9 avril 2024
mardi 5 mars 2024
THOMY BOURDELLE & RAMA TAHÉ dans Caïn Aventure des Mers Exotiques.
THOMY BOURDELLE est, dans Caïn de Léon Poirier, l'homme à la musculature puissante mais harmonieuse qui vit dans la plénitude de ses facultés, au milieu de la végétation luxuriante des régions exotiques. La nature est en effet, pourrait-on dire, le principal personnage du film. Elle domine de sa splendeur et de sa force l'homme et sa compagne qui, petit à petit, cependant arrivent à l'asservir et à utiliser, pour leur bonheur, ses multiples ressources. Thomy Bourdelle a fait de Caïn une création symbolique, qui évoque, avec une saisissante vérité, toutes les douleurs et toutes les joies de l'homme primitif.
dimanche 3 mars 2024
DEVANT LE CLOS VOUGEOT / Mon Ciné n°109 / 20 mars 1924
DEVANT LE CLOS VOUGEOT.
vendredi 1 mars 2024
EN BRIERE avec Léon Poirier et Thomy Bourdelle ( Cinéa n°18 / 01 août 1924 ).
EN BRIERE avec Léon POIRIER
lundi 26 février 2024
LES VACANCES DU DIABLE d'Alberto Cavalcanti / Ciné-Miroir, n°293, 14 novembre 1930.
mardi 20 février 2024
NOTRE COUVERTURE : Thomy Bourdelle / Ciné-Miroir, n° 275, 11 juillet 1930
Un jour que l'on questionnait Thomy Bourdelle sur ses débuts dans la carrière cinématographique, il répondit avec humour: «Oh! moi, je suis venu au cinéma... par la guillotine !» Il débuta, en effet, dans le rôle du bourreau de Jocelyn. Il avait eu la chance d'être présenté en cette occasion à Léon Poirier, et il faut croire que l'artiste débutant ne fit pas mauvaise impression au metteur en scène, car, depuis, Thomy Bourdelle a tourné, sous la direction de Léon Poirier l'Affaire du courrier de Lyon, Geneviève, La Brière, Verdun visions d'Histoire et, enfin, Caïn. Pour cette production, Thomy Bourdelle a vécu six mois dans la brousse malgache, à Madagascar, et il se déclare enchanté de son séjour dans la grande île.
« Au reste, ajoute-t-il, je me félicite tous les jours d'avoir connu Léon Poirier, qui m'a toujours admirablement conseillé et soutenu. Je pense, à l'instar de beaucoup d'autres, qu'il est à classer dans les tout premiers réalisateurs du monde entier et souhaite travailler avec lui le plus souvent possible. » Thomy Bourdelle fut encore un des principaux artistes de Surcouf, de Jean Chouan, des Fiançailles rouges, du Martyre de sainte Maxence, de la Divine Croisière. C'est un des meilleurs artistes de composition du cinéma français.
R. M.
lundi 19 février 2024
Un Grand Acteur de Composition - THOMY BOURDELLE. / ÈVE n°603, avril 1932.
Nous allons revoir Fantômas à l'écran, un Fantômas sonore et parlant, un Fantômas revu, corrigé et modernisé, pourrait-on dire. C'est Thomy Bourdelle qui joue le rôle de Juve, l'éternel adversaire du bandit qu'on ne voit jamais et qui sème cependant la terreur et la mort autour de lui.
vendredi 9 février 2024
Thomy Bourdelle, Vedette Rugbyman.
FRANCE. - Thomy Bourdelle, rugbyman et vedette des films "Caïn" et "A mi-chemin du ciel".
vendredi 26 janvier 2024
LE TOUT - POUR VOUS : BOURDELLE (Thomy) / Pour Vous n°373 du 9 Janvier 1936.
Thomy Bourdelle doit son prénom, qui n'est ni Thomas, ni Tommy, mais très exactement Thomy, à sa mère qui était d'origine irlandaise, tandis que son père était Normand. Il naquit à Paris, un 20 avril. Habite 150 bis, boulevard Pereire, à Paris ; envoie sa photo.
Particularités physiques et morales. — Taille : 1 m. 805, sous la toise. Poids : 88 kg. 500. Pesait 85 kilos à dix-huit ans. Solidement charpenté, n'a pas un pouce de graisse. Très sportif. Joue encore au rugby. S'entraîne régulièrement au Racing, à la Croix Catelan. A un cheval de selle, Silly Boy, et le monte régulièrement, mais trouve que c'est là un plaisir et non un véritable sport. Mais s'il avait eu poids et taille lui permettant de monter professionnellement en obstacles, n'aurait pas cherché d'autre carrière, car monter en course le passionne. Nage. Aime l'aviation et l'auto. Est trop vraiment sportif pour que la culture physique l'amuse. Pas tellement gourmand, n'apprécie guère non plus la boisson : croit que ces deux plaisirs lui manquent. Assez brutal, mais pas coléreux. Pas rancunier. Pas tellement ouvert, mais pas menteur non plus : fermé, tout simplement. Pense tout ce qu'il dit, mais est bien loin de dire tout ce qu'il pense. Aime la campagne, toute la nature ; a une petite ferme en Normandie où il passe tous ses loisirs ; il y réfléchit « à tout ce qu'on pourrait faire... si on pouvait », tant dans le domaine agricole que dans celui du cinéma. Son chien, Silly, est là-bas, un dalmatien. Beaucoup de poules. Un petit cheval de labour qui s'appelle Gamin. Aime la musique, l'entendre, pas en faire, car, dit-il, « il pianote comme un dégoûtant ». Le regrette, d'ailleurs. Regrette aussi de ne pas lire beaucoup, sauf en voyage, mais il y a deux raisons à cela : le temps passe trop vite — et Bourdelle n'aime pas les déceptions. Alors, il revient à quelques livres de chevet, toujours les mêmes, où il est sûr de trouver une substance à son goût. Bien qu'il se soit destiné à Centrale, il est aussi peu cartésien que possible et considère Pascal comme le Grand Maître. Reprend souvent -les Pensées...
Sa vie. — Etudes chez les frères de Passy, qui formaient les élèves en vue de Centrale. A leur exil en Belgique, il les suit au collège de Froyennes. Les études de piano étaient pendant les récréations : en moins de deux mois, le jeune Thomy avait compris... et renoncé pour toujours aux gammes. Le sport lui était, par contre, déjà cher et, à dix-huit ans, il était arrivé à la demi-finale du concours de l'athlète complet. C'étaient ses dernières vacances avant Centrale, il demanda à les passer au collège d'athlètes, au parc Pommery, à Reims, et se préparait à concourir pour la finale le 15 août. Mais ce 15 août était celui de 1914...
La démobilisation le trouva, en 1919, quelque peu désorienté : il n'était plus question pour lui de faire Centrale ! Il hésitait à rester dans l'armée, passa six mois dans la soierie à Lyon, puis tout à coup, comme ça, il se décida...
Au cinéma. — Deux semaines de trois cachets à 60 francs l'un lui étaient garanties lorsqu'il débuta dans Taxi 313 X-7, avec Saint-Granier, chez Gaumont, Pière Colombier metteur en scène. Il fit onze cachets au total ; ce fut donc, pour le temps, une affaire assez brillante. Vinrent ensuite : La Maison de Saint Cloud, Château historique, La Bouquetière des Innocents, Le Cousin Pons. A cause de ses muscles, Poirier lui confia le rôle du bourreau dans Jocelyn. Puis, il y eut Le Courrier de Lyon et Geneviève ; Surcouf, La Divine Croisière, Jean Chouan, Fanfan-la-Tulipe, Jocaste, Le Course au flambeau, Les Trois Mousquetaires. Avec Poirier, à nouveau, Verdun et Caïn, son rôle préféré. Poirier et lui étaient partis en Allemagne entendre les premiers parlants, et Poirier s'en inquiétait, « le français n'étant pas une langue universelle ». C'était, hélas ! vrai. Ensuite, Les Vacances du diable, A mi-chemin du ciel, Camp volant, Le Rebelle (encore un rôle qu'il aime, ainsi que le suivant), Le Docteur Mabuse, L'Etoile de Valencia, Adieu les beaux jours, Les Isolés, Fantômas, Mon ami Tim, La Maison dans la dune, Maria Chapdelaine, Un homme de trop à bord et Marika*, qui est à peine terminé.
* "Marika" fut plus tard rebaptisé "Les deux favoris"
Source : Pour Vous n°373 du 9 Janvier 1936
.
La Maison Dans La Dune de Pierre Billon (1934).
UN FILM DE QUALITE La Maison dans la Dune Un seul film nouveau cette semaine mais c'est un film français. Et de qualité. L'histoi...

-
Je cherchais depuis une huitaine de jours quelqu'un qui voulût me parler des Baléares. Je rencontrai bien un homme, qui, pendant une dem...
-
Comœdia, 5 décembre 1935 Comoedia , 12 décembre 1935. L’Écho de Paris, 13 décembre 1935 ...





s).jpeg)